
Newsletter n°2025 - semaine 45 du samedi 08 Novembre
COP 30 BRASIL - AMAZONIA
La 30e conférence des Nations Unies sur le climat se tient du jeudi 6 novembre au dimanche 21 novembre 2025 à Belém, au Brésil. Un lieu symbolique, tout juste 10 ans après la signature des Accords de Paris sur le climat.
NB : vous l’aurez compris, si vous êtes déjà un spécialiste de la RSE ou une grande entreprise, cet article n’est pas pour vous. Cet article est destiné aux ME (microentrepreneur effectif de moins de 10 personnes) et aux TPE/PME (effectif de moins de 250 personnes), concernées par la VSME (Norme Volontaire de rapport durable pour les TPE et PME).
Mais, cela peut servir de source d’inspiration, je l'espère ! Je vous laisse juge.
Voyons :
Bélem accueille la COP 30.
Les COP Climat fondatrices
L’accumulation mondiale des gaz à effet de serre
"Nous avons échoué à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés".
Les objectifs de la COP 30
Bélem
La ville de Bêlem do Para, capitale de l'état du Para, est un port industriel à 100 km de l'océan Atlantique, située non loin de l'embouchure du fleuve Amazone (6 600 km) et à la lisière de la forêt du même nom.
Arrive aussi à cet endroit, l'embouchure du fleuve Tocantins (2600 km), du rio Para, du rio Guama (400 km), du rio Acara (390 km).
La ville a été fondée en 1616 et compte environ 1.5 millions d'habitants, (métropole 2.1 M+)
Belém connait un climat équatorial sans saison sèche, température minima : 21°6 et maxima 32°.3.
Bêlem est la capitale de l'açaï (un fruit aux qualités nutritives exceptionnelle qui ressemble à la myrtille. Je vous conseille pour le petit-déjeuner. C'est excellent.
Bêlem accueille chaque année le "Cirio de Nazaré", reconnu patrimoine immatériel de l’Unesco" en l’honneur de Notre Dame de Nazareth.
Bêlem compte des favelas surpeuplées -57.1% de la population, sans végétation.
Bêlem est une ville de la musique, différente de celle du sud du Brésil.
Belém est devenue pendant plusieurs centaines d'années la ville la plus grande et la plus importante de toute l'Amazonie, grâce aux produits forestiers (épices, céréales, fruits, huiles, caoutchouc, graisse de poisson, cacao que les populations indigènes ont fait découvrir aux Européens) qui étaient apportés dans les marchés de la ville avant d'être expédiés vers d'autres régions du Brésil, les Caraïbes ou l'Europe".
L'idée du Président brésilien Lula, en choisisant Bêlem, est
>> de s'assurer
> "que la forêt amazonienne et les pressions qui pèsent sur cet écosystème seront au centre des discussions"
> " de faire de ce rendez-vous une "COP des peuples", for de la forte présence des peuples indigènes dans la ville,
>> faire comprendre de façon concrète aux dirigeants du monde entier les enjeux des discussions.
Bêlem do Para est jumelée avec Fort de France depuis 2011.
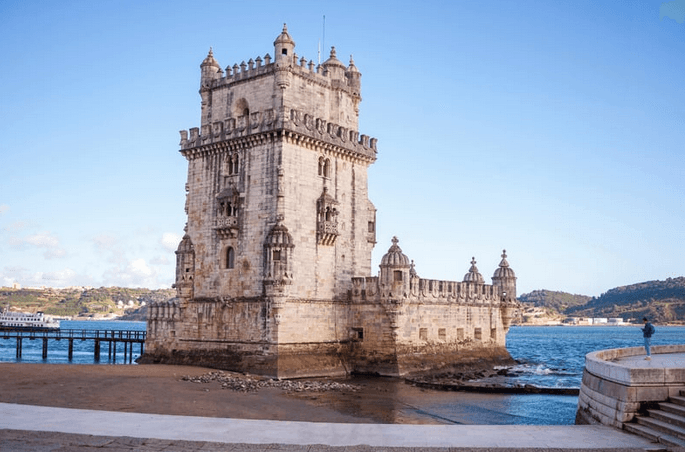




Photos : Canva
Les COP (Conferences of the Parties) climat fondatrices
Parties = Etats
Le Sommet de RIO - 1992
Le sommet de Rio de 1992, [la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement], s'est tenu à Rio de Janeiro en juin 1992.
Les participants (120 chefs d'États et de gouvernements, ainsi que des milliers de représentants d'ONG, d'activistes et d'experts), ont affirmé que le progrès économique et la protection de l’environnement sont indissociables et ont posé les bases du développement durable. Ils ont redéfini les priorités mondiales, ce qui a abouti à :
La Déclaration de Rio, qui énonce 27 principes universels,
L’adoption de la Convention-cadre sur les changements climatiques,
La Convention sur la biodiversité et
La Convention sur la lutte contre la désertification
Un plan d’action nommé Agenda 21, composé de plus de 2 500 recommandations, pour orienter les politiques et mobiliser les gouvernements autour de la préservation de la planète, devenu depuis 2015, l'Agenda 2030 autour des 17 ODD (objectifs de développement durable).
Ce sommet est considéré comme un moment fondateur pour la reconnaissance du développement durable et son inscription au cœur des politiques internationales.
Le PROTOCOLE DE KYOTO (COP 03) - 1997
Le Protocole de Kyoto, adopté lors de la COP 3 à Kyoto en décembre 1997 et entré en vigueur en 2005, est un accord international contraignant visant à lutter contre le réchauffement climatique.
Il impose à 38 pays industrialisés et à l’Union européenne de réduire, leurs émissions de six principaux gaz à effet de serre (CO₂, méthane, protoxyde d’azote, HFC, PFC, SF₆) d’au moins 5% par rapport à leur niveau de 1990, sur la période 2008 et 2012.
Aucune sanction n'est cependant prévue si cet objectif n'est pas atteint .
Les pays en développement (en 1997) comme le Brésil, la Chine ou l’Inde, également parties au protocole, ne sont pas soumis à la réduction d’émissions.
Malgré certaines avancées, le bilan du protocole est mitigé : plusieurs grands émetteurs, dont les États-Unis, ne l’ont pas ratifié ou s’en sont retirés, limitant son impact global.
Cependant, il marque une étape fondatrice en instaurant un cadre légal international pour la réduction des émissions.
La COP 18 de Doha organisée en 2012 aboutit à l'adoption d'un amendement au protocole de Kyoto qui prévoit une deuxième période d’engagement pour la période 2013-2020.
37 pays industrialisés s'engagent à réduire les émissions de GES d’au moins 18% (toujours par rapport à 1990) au cours de cette période. Des pays industrialisés comme les États-Unis, le Canada, la Russie et le Japon ne s'engagent pas ou plus à réduire leurs émission de GES.
L'ACCORD DE PARIS - (COP 21) - 2015
Les accords de Paris ont été adoptés lors de la COP 21 en décembre 2015 par 195 pays, marquant un tournant historique dans la lutte mondiale contre le changement climatique.
Ce traité engage la communauté internationale à limiter le réchauffement planétaire bien en dessous de 2°C par rapport à l’ère préindustrielle, avec l’objectif supplémentaire de tendre vers 1,5°C afin de réduire les risques et impacts liés au climat.
Chaque pays doit soumettre des contributions nationales (NDC) régulièrement réévaluées à la hausse, créant une dynamique d’ambition croissante via le principe du « cliquet ».
L’accord vise aussi l’atteinte de la neutralité carbone au cours du XXIe siècle, en assurant que les émissions anthropiques soient absorbées par des puits naturels ou technologiques.
Un volet essentiel de ces accords concerne la solidarité envers les pays en développement : le Fonds vert pour le climat mobilise 100 milliards de dollars par an dès 2020 pour soutenir l’atténuation et l’adaptation. L’accord repose sur un cadre juridique universel, fondé sur la transparence, le suivi des progrès et la coopération, impliquant également acteurs non étatiques, collectivités et citoyens pour réussir la transition.
L’accumulation mondiale des gaz à effet de serre
Le bulletin annuel de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) met en évidence une nouvelle augmentation des gaz à effet de serre (publication du 28 octobre 2024).
Les concentrations de dioxyde de carbone (CO2), de méthane (CH4) et d'oxyde nitreux (=protoxyde d'azote) (N2O) atteignent respectivement 151%, 265% et 125% des niveaux préindustriels (avant 1750).
soit des coefficients multiplicateurs de 2,51, 3,65 et 2,25 par rapport aux concentrations avant 1750.
IL faut lire : les concentrations moyennes mondiales de (CO2), ont été multipliées par 2.5 par rapport aux valeurs préindustrielles.
Le dioxyde de carbone représente environ 64% de l'effet de réchauffement sur le climat et il est principalement issu de la combustion de combustibles fossiles et de la production de ciment.
Une grande partie des gaz à effet de serre n’est absorbée ni par la végétation, ni par les sols.
un peu moins de 50% des émissions de CO2 restent dans l’atmosphère.
Un peu plus de 25% sont absorbées par les océans
un peu moins de 30% sont absorbées par les écosystèmes terrestres.
Cette capacité d’absorption pourrait diminuer dans les années à venir. "Les écosystèmes pourraient très bientôt devenir des sources plus importantes de gaz à effet de serre sous l’effet du changement climatique.
Les incendies de forêt pourraient libérer davantage d’émissions de carbone dans l’atmosphère,
tandis que l’océan plus chaud absorberait moins de CO2
Par conséquent, davantage de CO2 pourrait rester dans l’atmosphère et accélérer le réchauffement de la planète".
A noter, les gaz mettent un certain temps à se dissoudre dans l'atmosphère :
CO2 (gaz carbonique) : entre 300 et 1000 ans
CH4 (méthane) : 10 à 12 ans mais son "effet de serre" est 28 fois plus puissant que celui du CO2
N20 (protoxyde d'azote) : 114 ans mais son "effet de serre" est 300 fois plus puissant que celui du CO2. IL appauvrit aussi l'ozone stratosphérique
"Nous avons échoué à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés".
Comme rappelé ci-dessus, les accords de Paris engagent la communauté internationale à limiter le réchauffement planétaire bien en dessous de 2°C par rapport à l’ère préindustrielle, avec l’objectif supplémentaire de tendre vers 1,5°C.
Or le réchauffement climatique ne faiblit pas, alerte l'Organisation météorologique mondiale.
Les 11 dernières années ont été les plus chaudes enregistrées en 176 ans d'observations.
Pour 2025, la température moyenne entre janvier et août a été supérieure de 1,42 degrés à la moyenne préindustrielle.
Selon le programme de surveillance de la terre de l’Union européenne Copernicus, 2024 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée depuis 1850, dépassant pour la première fois le seuil des 1,5 °C de réchauffement par rapport à l’ère préindustrielle.
Et 2024 a aussi été l'année des records mondiaux pour :
les niveaux de gaz à effet de serre
la température de l’air
la température à la surface de la mer
la charge de vapeur d’eau dans l’atmosphère (et donc le potentiel de précipitations extrêmes)
contribuant à des événements extrêmes, notamment des inondations, des vagues de chaleur et des incendies de forêt.
Copernicus souligne aussi que le continent européen se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale depuis les années 1980.
Le continent européen est celui qui se réchauffe le plus rapidement sur Terre.
A Belém do Para, ce jeudi 6 novembre 2025, le Secrétaire général des Nations Unies a exhorté les dirigeants mondiaux à agir rapidement et à grande échelle pour maintenir le réchauffement mondial en dessous de 1,5 °C.
"Tout dépassement doit être aussi faible, bref et sans danger que possible, a-t-il souligné, en rappelant les conséquences irréversibles que chaque fraction de degré entraîne sur les vies, les économies et les écosystèmes. Les solutions existent déjà, mais les pays doivent agir de toute urgence :
Investir dans les énergies propres,
éliminer progressivement les combustibles fossiles,
mettre fin à la déforestation et inverser la tendance
réduire les émissions de méthane
et garantir 1 300 milliards de dollars de financement climatique pour les pays en développement d'ici 2035."
Sources : Accès au discours d'Antonio Guterres le 6 novembre 2025 à Belém
Les objectifs de la COP 30
La COP 30, organisée à Bélem do Para s’annonce comme une étape charnière pour l’action climatique mondiale, dans un contexte d’urgence environnementale, économique et sociale inédit.
Objectifs majeurs de la COP 30
La COP 30 vise d’abord à traduire et accélérer la mise en œuvre concrète de l’Accord de Paris, dix ans après son adoption, en exigeant des États qu’ils présentent des objectifs nationaux renforcés de réduction des émissions (NDC) pour 2035, alignés sur une trajectoire permettant de limiter le réchauffement mondial à 1,5 °C.
Sous présidence brésilienne, la conférence entend devenir la COP de l’« action » et de la « justice climatique », articulant transition écologique, inclusion sociale et respect des savoirs autochtones, notamment au cœur du bassin amazonien.
Dans cet esprit, l’Agenda de l’Action sera redynamisé autour d’un « mutirão climatique », concept inspiré des communautés indigènes, qui évoque la coopération collective pour relever un défi commun.
Trois priorités transversales structurent l’événement :
Renforcer le multilatéralisme et le régime international de lutte contre le changement climatique.
Relier le processus climatique à la vie réelle des populations, en intégrant bioéconomie, économie circulaire, villes durables, santé, droits humains, technologies vertes, et savoirs autochtones.
Accélérer la transition vers la neutralité carbone à travers la réduction des énergies fossiles, la décarbonation industrielle et des engagements financiers renouvelés.
La mobilisation des financements :
Il s’agit notamment de concrétiser la promesse de 1 300 milliards de dollars par an, dès 2035, pour aider les pays les plus vulnérables à s’adapter et à engager leur transition et de réguler en ce sens les flux mondiaux.
Le suivi des progrès repose sur l’adoption de 100 indicateurs d’adaptation et la réorientation massive des flux financiers dans le respect des objectifs de l’Accord de Paris.
Le président brésilien Lula souhaite mettre au cœur des discussions la protection des forêts, en particulier amazoniennes. Le Brésil se mobilise pour la création d’un fonds d’investissement pour lutter contre la déforestation en zone tropicale, le « Tropical forever forest facilities » (TFFF), avec un objectif de financement de 125 milliards de dollars.
Toujours dans le but d’attirer des investisseurs, la présidence brésilienne portera également un agenda visant à « multiplier par quatre la production mondiale et l’utilisation de carburants durables d’ici à 2035 ».
Des annonces sont en outre attendues de la part de la coalition d’États engagés en faveur de la taxation des billets d’avion premium et des voyages en jet privé.
La question environnementale :
Le fait que la COP 30 soit organisée aux portes de l’Amazonie, met en lumière la nécessité impérieuse
> de préserver les forêts et les écosystèmes clés,
> d’en finir avec la déforestation et
> de promouvoir les solutions fondées sur la nature
comme facteur de résilience durable face aux chocs climatiques.
Les forêts amazoniennes sont vues à la fois comme un laboratoire vivant et un symbole mondial du combat climatique, alors qu’elles se situent proches du point de non-retour selon de nombreux experts.
La question sociale :
La COP30 inscrit l’agenda social comme pilier essentiel de l’action climatique mondiale, en visant des politiques publiques qui articulent justice, inclusion et développement humain avec l’ambition de neutralité carbone.
Déclaration de Belém sur la lutte contre la pauvreté et la faim : Cette déclaration officielle engage les parties à :
Étendre les systèmes de protection sociale et d’assistance d’urgence sensibles au climat.
Intégrer la protection sociale aux dispositifs d’alerte, d’anticipation, de gestion des pertes et dommages, et aux politiques environnementales.
Lier la protection sociale à la nutrition, la santé, l’éducation, les moyens de subsistance, la résilience et l’adaptation à long terme.
Transition juste et emplois durables :
Promouvoir la création d’emplois verts et décents dans les régions vulnérables et rurales (notamment pour les petits agriculteurs, peuples autochtones et communautés forestières).
Soutenir la formation, la reconversion professionnelle et les mécanismes d’accompagnement pour les travailleurs impactés par la transition énergétique.
Renforcer l’implication des travailleurs et des syndicats dans les négociations et orientations stratégiques concernant la transition, suivant la notion de « transition juste » adoptée par l’OIT (Organisation internationale du travail).
Participation et gouvernance inclusive :
Accroître la participation effective des populations autochtones, des femmes et des groupes marginalisés à la prise de décision.
Mettre en place des dispositifs de dialogue permanent avec la société civile (« People’s Circle », hautes commissions autochtones, etc.).
Éducation, santé, égalité et lutte contre les inégalités :
Reconnaître le rôle central de l’éducation, de la santé et de l’égalité dans la résilience climatique.
Soutenir des programmes ciblant la lutte contre la pauvreté, l’accès aux soins, la sécurité alimentaire et l’amélioration des conditions de vie face aux impacts climatiques.
Intégrer davantage la recherche scientifique
La Plateforme océan et climat (POC), qui regroupe différents acteurs de la société civile avec l’appui de la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’Unesco, appelle à consolider les moyens accordés à la recherche, et à faire un meilleur usage de ces connaissances à travers leur diffusion au grand public et leur intégration aux processus de décisions.
« La priorité est de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, de mettre fin aux pratiques néfastes et de s’assurer de ne pas en introduire de nouvelles (ex : exploitation des grands fonds marins) », argumente la POC.
Définir l’objectif mondial d’adaptation aux changements climatiques
La question de l’adaptation au changement climatique, bien que moins mentionnée par les Brésiliens, sera également un des enjeux de la COP 30.
Les États seront ainsi chargés de progresser sur la définition de l’objectif mondial d’adaptation (OMA) prévu par l’article 7 de l’accord de Paris, « qui ne connaît pas encore de traduction opérationnelle, faute d’indicateurs fiables pour mesurer les efforts et les moyens fournis.
La mise en œuvre du Bilan mondial de 2023
Cette édition de la COP climat ouvre le troisième cycle des contributions déterminées au niveau national (CDNN), prévues de manière quinquennale par l’accord de Paris, Qui sont en quelque sorte les feuilles de route climat par État.
Prévu par l’accord de Paris, le bilan mondial est une évaluation des progrès réalisés depuis la signature de 2015. Il identifie également les chantiers persistants pour atteindre les objectifs climatiques ainsi que les approches nationales et internationales permettant de renforcer les efforts.
À partir du premier bilan de 2023, il doit être réalisé tous les cinq ans.
à suivre ...
La COP 30 a lieu dans un contexte où la confiance envers le multilatéralisme (attitude politique qui privilégie le règlement des problèmes mondiaux auquel participent plus de deux nations ou parties.) s’érode, sur fond de tensions géopolitiques.
La COP 30 de Bélem doit marquer un nouveau départ collectif, au milieu d'une décennie considérée comme cruciale, en rectifiant le fossé entre science climatique et ambitions politiques, en prouvant la crédibilité des promesses et en engageant la société dans un modèle de développement réellement durable, juste et inclusif.
à bientôt dans un prochain post : pour en savoir plus, continuer à se former, échanger les bonnes pratiques et changer nos habitudes.
Transition écologique signifie avant tout Transformation des modes de vie.
Bonne semaine !
N’hésitez pas à vous abonner et à liker bien sûr.
En parler ? https://www.rsepourtous.fr/rendez-vous

Durablement Vôtre
RSE POUR TOUS
Copyright Véronique Mascré//RSE pour Tous - Tous droits réservés
